Les champs changent
Les temps changent, nos façons de pratiquer l’agriculture aussi. Grâce à l’acquisition des connaissances, nos méthodes sont en constante évolution et permettent de produire des aliments de qualité tout en réduisant l’impact sur l’environnement. Pour y voir plus clair, voici six grands enjeux pour lesquels les producteurs agricoles du Québec sont en mode action et travaillent au quotidien à toujours faire mieux.
Fiches d’information
-

Les pesticides
L’utilisation des pesticides en agriculture représente un enjeu important, tant pour les producteurs que pour la population. Leur usage soulève bien des questions. Que font les producteurs pour en réduire l’usage? Quelles sont les solutions de rechange?
En savoir plus -
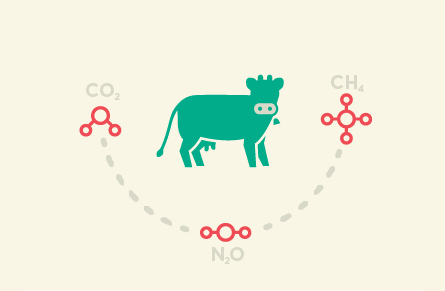
Les gaz à effet de serre
Comme plusieurs secteurs économiques, l’agriculture contribue à la production de GES. Élevage, culture des sols, gestion des fumiers, voilà autant de sources que l’on retrouve à la ferme. Les élevages sont souvent pointés du doigt. Qu’en est-il au Québec?
En savoir plus -
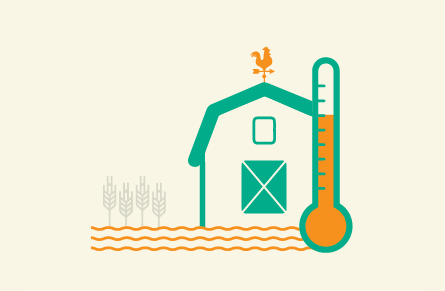
Les changements climatiques
Le secteur de l’agriculture est l’un des plus touchés par les changements du climat. Au Québec, on en subit déjà les effets. Les producteurs travaillent avec les experts pour mieux y faire face. L’agriculture et la foresterie font partie des solutions.
En savoir plus -

La santé des sols
Un sol en santé, synonyme de fertilité et de bon rendement, est primordial en agriculture. Les agriculteurs du Québec, avec l’aide de leurs conseillers techniques, adoptent ainsi des pratiques de plus en plus durables pour garder leur sol bien vivant.
En savoir plus -

La consommation d’eau
L’eau est essentielle pour cultiver les plantes et abreuver les animaux. Même si elle abonde, au Québec, les producteurs l’économisent et respectent des normes strictes. L’élevage est souvent accusé d’en utiliser trop, mais les pratiques d’ici diffèrent.
En savoir plus -

Le bien-être animal
Les éleveurs ont à cœur le bien-être de leurs troupeaux et les soignent au quotidien avec bienveillance. Ils se sont aussi dotés de codes de pratiques, et les conditions d’élevage évoluent selon les connaissances scientifiques.
En savoir plus